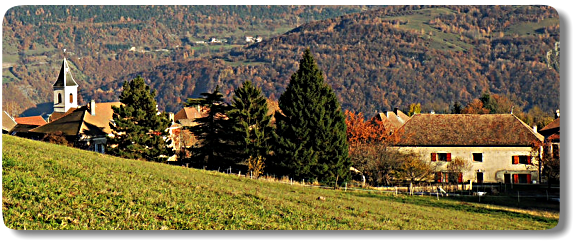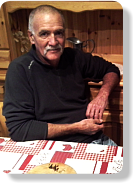Paul et Maryse Riondet
Paul Riondet, 57 ans, est né d’une famille très
ancienne dont la présence ici remonte au 17ème
siècle. Il est le fils de Marcel Riondet, qui avait
écrit dans les années 50 le texte consacré à la
journée de battage, et peint ce paysage de la
Meije visible chez Jean-Claude et Simone
Sarrat. De son père, Paul a retenu ce sens de
l’esthétique de la nature qui fait de lui un
photographe plein de sensibilité.
Maryse son épouse est une Fanjat, la sœur
d’Alain, aussi une très ancienne famille du
plateau. Tous deux se connaissent donc depuis
leur enfance à la Salle, depuis qu’ensemble ils
allaient à l’école, d’abord sous la férule de
Madame Gorde, puis sous celle, bien plus stricte,
de Monsieur Gorde… Tout gamins ils
s’entendaient bien, et à 13 ans étaient déjà
toujours ensemble. Et aujourd'hui les voici…
Paul évoque ses souvenirs d’enfance avec son
père, avec qui il allait pêcher sur les rives du
Drac, qui à l’époque n’était pas domestiqué
comme maintenant. Le barrage de Commiers
n’existait pas encore, et c’était un vrai torrent,
dangereux, d’où son nom, Drac, qui veut dire en
effet dragon, parce qu’il en a pris des vies ce
méchant cours d’eau. Les crues étaient
phénoménales, on raconte que le Pont de Claix
avait été endommagé. Plus près de nous, Paul
se souvient qu’on traversait entre le ruisseau
d’Ars et la plage de Sarteur à l’aide d’une espèce
de bac rudimentaire, une nacelle suspendue à un
câble, sur lequel on se halait vers l’autre rive…
Mais qu’importaient les dangers, Paul et son père
y allaient pêcher aussi souvent que possible,
truites, barbeaux, chevesnes, suif également, et
le gamin apprenait ainsi les délices de la vie au
grand air.
Nous les enfants on était toujours mis à
contribution pour aider aux travaux des champs
et des fermes, comme le battage, auquel tout le
monde participait, mais aussi les vendanges.
C’était énorme, les vendanges. Tout le versant
du Drac, c’était planté en vignes, et on produisait
suffisamment pour vendre son vin. Le rouge
était un peu âpre, mais le blanc descendait
bien…
Pendant ce temps, Maryse était confiée durant
les vacances à sa grand-mère de Brignoud…
L’hiver, on skiait, parfois avec l’instituteur
mais pas seulement. Tous les enfants
ensemble, on commençait par damer la pente
sur la Cluze, en montant et descendant
plusieurs fois dans la neige jusqu’aux genoux
jusqu’à obtenir une belle pente bien tassée, bien
lisse, du coup la neige pouvait tenir bien plus
longtemps. L’autre pente, celle du pré
Faucherand, c’était pour les lugeurs. Tous les
soirs après l’école avant la nuit, on y était. Pas
besoin de gros équipements, avec toute cette
activité on n’avait pas froid…
Maryse : Je me souviens aussi du chasse-
neige, qui était tiré par des chevaux, c’était
mon père Amédée Fanjat qui menait
l’attelage. Ce n’était pas évident, quand la
neige était trop tassée, ça soulevait l’étrave
en bois, et il fallait y aller à la pioche, tout le
monde s'y mettait. Il y avait une vraie
solidarité des villageois entre eux.
Tous deux se souviennent du spectacle
qu’offrait la place devant l’école pendant les
récréations. Le nez collé aux barrières, les
gamins regardaient et écoutaient les dames
venues laver leur linge au bassin.
On voyait aussi les chevaux, se rappelle
Maryse, de gros percherons, et les vaches,
qui traversaient la place pour boire à la
fontaine.
Paul renchérit : Je me rappelle bien l’alambic,
on venait l'installer sur la place. C'était une
belle machine en cuivre montée sur une
charrette, chauffée avec du bois amené par
les clients eux-mêmes, en même temps que
le marc de raisin, les poires ou les pommes
dont on voulait tirer diverses gnôles. Je vous
explique pas les vapeurs qui nous
parvenaient aux narines…! L'alambic passait
tour à tour dans les villages de la région,
alors que maintenant les gens se déplacent
pour aller chez le bouilleur de cru avec leur
matière première.
Quand j'avais… je crois, cinq ans, j'ai vu ma
première pelle mécanique travailler, j'étais
fasciné par la puissance et le bruit de cet
engin qui éventrait la place du village, c’était
quand ils mettaient l’eau courante, il y avait
de la terre, des monceaux de cailloux, des
tranchées partout, c'était comme une scène
de guerre.
Qu'est-ce qui vous a marqués tous les
deux dans la vie du village à l'époque ?
Il y avait la fête, quand on tuait le cochon.
C’était le Yves Allard, le père de Michèle, qui
tuait la bête pour tout la famille. Chaque
famille ou presque avait un cochon, et on
partageait, on mettait la
viande dans des saloirs,
c'est une sorte de jarre en
terre cuite haute comme ça
(entre 40 et 60cm). C'était
l'unique façon de conserver la
viande à l'époque. Pas de
frigidaire, encore moins de
congélateur bien sûr.